
PASCAL DIBIE, 2006
Le village métamorphosé : révolution dans la France profonde.
Coll. Terre Humaine, Plon.
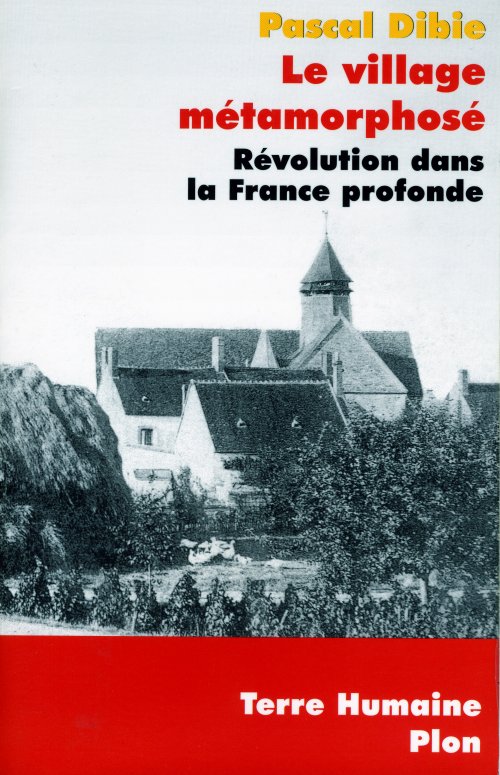
Il y a plus de 60 ans René Dumont publiait ses Voyages en France d'un agronome à partir d'enquêtes réalisées de 1933 à 1950. Plus récemment, en 1977, et en compagnie de François de Ravignan, il retourne dans les villages et sur les fermes étudiés alors, en complétant, en élargissant et en diversifiant son enquête, il en trace l'évolution et montre l'extrême variété des situations. La méthode était donc de développer des monographies et de constater l’évolution dans le temps de ces villages et de ces fermes. Aujourd’hui Pascal Dibie reprend la même méthode en l’appliquant cependant à un seul village, son village qu’il photographie à 27 ans d’intervalle (1979 : Le village retrouvé ; 2006 : Le village métamorphosé). Entre ces différents auteurs, les buts sont différents. Dans le premier cas un diagnostic est posé pour la recherche d’une nouvelle politique agricole ; et pour résoudre ce problème les conditions de base doivent être connues. Cette politique est examinée à l’échelle mondiale : cf par exemple les désastres écologiques avec la prévision d’une potentialité agricole de plus en plus limitée, des steppes semi-arides fragiles. En définitive, ce sont les soucis d’un agronome qui sont exposés... En revanche, P. Dibie ne voit pas la campagne en agronome mais en ethnologue. Il nous invite à revisiter notre société qui est en train de vivre, selon l’expression de l’éditeur « une des plus grandes mutations de son histoire ». L’intérêt est de trouver dans ce livre, la description de nos actes les plus modestes : le repassage, le feuilleton à la télévision, les courses au supermarché, le repas, la décoration, les activités féminines, le traitement des déchets…Description ? pas seulement ... il y a aussi une analyse par petites touches dispersées. Ecoutons l’auteur.
« Quand jeter devient complexe, c'est que le pot déborde, donc que la société connaît une mutation profonde. Ce bruit de balayeuse, ce bruit urbain me trouble parce qu'il vient désorganiser des souvenirs psychologiques et écologiques et qu'il annonce la mise en place d'autres cadres sociaux dans lesquels je vais devoir m'insérer. La violence ressentie vient de la rencontre de deux univers et de l'obligation à un réveil, à une prise de conscience critique à l'égard d'un système hybride, rural ou/et urbain, dans lequel il va falloir s'arranger. La question des poubelles, c'est-à-dire de nos déchets nouveaux et de leur gestion, le maire avait raison, n'est pas une mince affaire ». (p107) « La télé imposait son diktat horaire et sa voix, alors que de l'étage supérieur nous parvenaient les glouglous étranges d'un jeu vidéo. Cette scène vécue mille fois, qui menace chez moi comme chez vous, est je le sais d'une banalité considérable, mais la fin organisée de la commensalité familiale, la disparition du repas que nous appelions la table, si importante dans notre culture et nos religions, me paraît être, avec le non-traitement de la mort, une des causes majeures de notre déshérence rituelle». (p147)
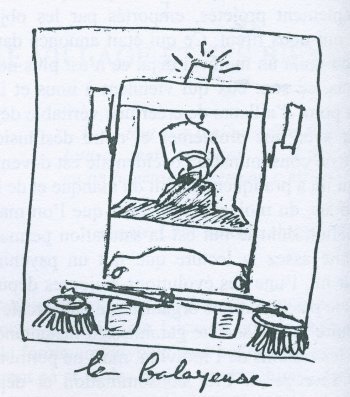
« Il alluma le plafonnier. La lumière crue, et mon état peut-être, mirent en relief le décor de la pièce dont je n’avais jusque-là ressenti que le confort. La présence de ce mobilier normalisé à outrance me rappelait que l’on n’habite jamais que la culture qui nous habite, et que les choix de décoration sont aujourd’hui presque totalement dépendants de l’offre qui nous en est faite ». (p149).
« Nous sommes devenus tous la même personne, nous pensons à peu près tous pareil - du moins on nous le fait croire -, nous achetons, vivons de la même façon sans être ensemble. Comme les objets, nos vies sont devenues additives, en un mot toutes semblables, dépassionnées, désinscrites du communautaire, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, bien au contraire, mais la « prise » sur la réalité ne passe plus que par des intermédiaires matériels et techniques » (p 26).
« La défaite de la mort. On me dira que j’insiste un peu trop sur cette question, mais quelque chose dans nos comportements et notre vision de la mort s’est si profondément modifié ces dernières années que je ne puis l’ignorer, tant cela me parait révélateur de ce que nous ne sommes plus….Désormais, tout le monde, ou presque, meurt à l’hôpital ou dans l’ambulance, le plus souvent au grand soulagement des familles. Pour peu que ces dernières soient recomposées, elles ont bien du mal avec leurs morts pour trouver le « comment » du rituel, sinon le « où » du caveau…La défaite de la mort a bien eu lieu, non pas dans le sens chrétien, mais dans le sens économique, par son exclusion de nos préoccupations et par la perte d’un savoir-faire autour des morts ». (p.223).
Au-delà de ces remarques l’auteur explique son métier.
« Il faudrait que je réussisse à dire les choses assez fortement pour ceux qui se refusent à entendre que les sciences de l'homme sont aussi à construire avec le sensible. C'est cela être « totalitaire », c'est être un « être total », c'est être avec soi, en accord avec soi. Ionesco parlait de « l'humble orgueil d'être soi». Comment pourrais-je faire de l'ethnologie contre moi ? Il ne peut y avoir de création si elle est contre son créateur, elle ne peut être qu’un prolongement, une plongée en lui-même, un passage par le profond de l'homme, là où il alchimise pensée et poésie. » (p.128). Et plus loin
« Partager, « apprendre, comprendre et partager », pour reprendre André Leroi-Gourhan, qui insistait sur le fait que « tout ce qui n'est pas partagé est perdu », me paraît essentiel dans l'acte de faire de l'ethnologie. Partager au sens ethnologique, cela veut dire tout autant restituer aux «ethnologisés» ce que l'on a perçu d'eux, faire connaître à sa propre communauté ce que l'on imagine que nous sommes et, dans un double retournement, offrir en dialogue, et non en cherchant à les imposer, les connaissances que nous avons du monde et de sa conception tout en acceptant d'entendre le rapport à l'univers que ces autres si différents articulent. Cela implique que nous revenions à ce que Serge Moscovici appelle « une conception poreuse du monde, à un système ouvert», moins conceptuel, de l'ethnologie, où le chercheur accepte de reconnaître que rien n'est jamais définitivement constitué, ni entièrement déterminable. » (p.371)
L’intérêt du livre est précisément de mettre à disposition une vision, une lecture de nos actes les plus modestes, de tout ce qui peut paraître banal et qui fait notre quotidien. Il « épluche » ce monde dans lequel « la voiture, la cybernétique, la consommation sont maîtresses de nos têtes, de nos temps, de notre économie, où la religion s’abstrait jusqu’à accepter le changement des rites funéraires, où l’agriculture se « scientifise » à outrance et nos paysages se « patrimonialisent ». Ce livre plaira probablement beaucoup parce que chacun de nous se retrouvera aisément; les personnages ne sont pas isolés mais inscrits dans leur contexte sociologique, économique ou politique. Vraiment un très bon livre.
Et maintenant...A table! (p 143)

En attendant, les pis de nos vaches restent une valeur sûre. Le lait maintenu à température constante est à l'abri des microbes, et surtout il est protégé de tout risque de fermentation. Ici, chaque vache est reliée à son ordinateur, ou plutôt à son programme. Les vingt-quatre « appareils » répartis au-dessus des deux quais se faisant face sont activés par le kit d'identification que chacune des vaches porte à son col. Dès qu'elles franchissent le portique électronique de la salle de traite, dès qu'on branche les manchons à la mamelle, les ordinateurs se mettent en service. Une pression sur le bouton vert et, en haut, à droite de la console qui mesure environ quarante centimètres sur vingt, le numéro de l'animal s'affiche en rouge. Au-dessous, les chiffres défilent, indiquant la tare de lait que la vache est en train de produire. Dès que les griffes sont déprises, un chiffre indique la variation par rapport aux sept dernières traites effectuées sur l'« unité ». En haut et à gauche du cadran, un code apparaît quand la vache n'a pas suffisamment de lait pour être traite, ou que le lait n'est pas de bonne qualité pour quelque raison, ou encore quand une mammite se profile. A partir de cet ordinateur, on peut bien sûr obtenir de plus amples données à propos de la vache sur la sellette, que l'on peut aller consulter directement sur l'ordinateur central dans le bureau attenant, afin de vérifier à la minute près l'état de rentabilité de l'« unité laitière » : rendement du lait, consommation alimentaire, maternités passées et à venir, état sanitaire, rentabilité de l'animal, date de mise à la retraite... Oui, on sait tout déjà du devenir de cette tête bovine que l'on connaît surtout par ses arrières...

